Titulaire d’un DESS en finance banking islamique, assurance islamique à l'Université ALHUDA CIBE, au Pakistan, et diplômé en logistique, en management de projets, Issa Malgoubri est de cette nouvelle génération de jeunes chefs d’entreprises stratèges et visionnaires qui brisent les codes, sort de sentiers battus pour réinventer l’entrepreneuriat et la finance sur le continent africain. Auteur d’un livre intitulé : "L’épargne communautaire et l’entrepreneuriat collectif au Burkina Faso", ce jeune entrepreneur multi-casquette, pluridisciplinaire, spécialiste en finance islamique, assurance islamique, innovation financière et ingénierie financière est à la tête de plusieurs entreprises dont la Société de gestion et d’intermédiation financière IMAGE Finances Internationales (SGI-IFI), la quatrième SGI du Burkina Faso. Son engagement entrepreneurial est fondé sur sa vision de toujours concilier finance, éthique, souveraineté et impact. A travers SGI-IFI, dont il est le Président-Directeur-Général (PDG), M. Malgoubri a la lourde et historique responsabilité de conduire la structuration d’une opération financière toute aussi historique : la première obligation islamique ou Sukuk du Burkina Faso sur le marché financier régional. Dans cette interview qu’il a accordée à C’Finance, il aborde, avec expertise et pédagogie, les différents contours de ce Sukuk, le processus de son opérationnalisation, les avantages de cet instrument financier éthique, respectueux des principes religieux et qui permet aux Etats africains de financer leurs besoins d’infrastructures massives, sans pour autant alourdir leurs dettes publiques extérieures. Il y évoque également les défis juridiques, opérationnels et communicationnels à relever pour créer un environnement propice au développement de la finance islamique et des obligations islamiques au Burkina Faso et dans la sous-région.
C’Finance (C.F) : Vous êtes le PDG de la Société de gestion et d’intermédiation IMAGE Finances Internationales (SGI-IFI). Pouvez-vous présenter ce quatrième et dernier né des SGI du Burkina Faso ?
Issa Malgoubri (I.M) : La création de SGI-IFI est l’aboutissement de deux années de réflexion stratégique. Notre ambition est claire : réinventer la finance au service du développement souverain et durable des États et des peuples. Nous intervenons dans la structuration des titres publics (bons et obligations), des Sukuk, des opérations de levée de fonds privés et institutionnels, ainsi que dans l’ingénierie financière innovante (crédit carbone, titrisation, financement vert, obligations vertes, etc.).
En tant que quatrième SGI du Burkina Faso, créée en septembre 2024, nous avons la chance de capitaliser sur l’expérience de nos devanciers – SBIF, Coris Bourse et SA2IF – et d’apporter notre touche d’innovation. Notre vision repose sur une conviction profonde : concilier finance, éthique, souveraineté et impact. Je profite donc pour leur rendre un hommage appuyé à ces devanciers du Burkina Faso.
C.F : La SGI-IFI que vous dirigez pilote actuellement la structuration d’une opération financière historique au profit de l’Etat Burkinabè : le premier SUKUK souverain ou obligation islamique de l’histoire du pays. Pouvez-vous définir cet instrument financier islamique qu’est le Sukuk ?
I.M : Le Sukuk est l’équivalent islamique d’une obligation, mais fondé sur des actifs tangibles et dépourvu d’intérêt. Contrairement à une obligation classique qui repose sur le paiement d’intérêts fixes (Riba, interdit en islam), le Sukuk est basé sur le partage des risques et des bénéfices.
Prenons l’exemple du contrat Ijara (location-financement), qui sera utilisé pour le Burkina Faso. Les investisseurs financent un actif (bâtiment, route, barrage) mis à la disposition de l’État, lequel verse des loyers. Ces loyers servent à rémunérer les investisseurs. Il ne s’agit donc pas d’un enrichissement sans cause, mais d’une participation réelle à un projet.
Le Sukuk peut prendre différentes formes – copropriété, partenariat (Musharaka), ou location (Ijara). Dans tous les cas, l’investisseur islamique n’est pas passif : il s’implique dans la réussite du projet et partage équitablement les résultats, qu’il s’agisse de profits ou de pertes.
C.F : Concrètement, en quoi va consister ce Sukuk de l’Etat burkinabè ?
I.M : Il s’agit d’un Sukuk Ijara (locatif) adossé à des actifs publics identifiés. L’État met à disposition des actifs dans un Fonds Commun d’Émission de Sukuk (FCES). Les investisseurs perçoivent des loyers proportionnels à leur participation, et à la fin de la maturité, ils récupèrent leur capital.
Les projets concernés incluent des routes, écoles et hôpitaux prioritaires définis par le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB). Cela permet de financer des infrastructures stratégiques sans accroître la dette extérieure classique, car le Sukuk n’exige pas de garantie souveraine.
C.F : Concrètement, à quoi servir ce premier Sukuk de l'État burkinabè ?
I.M : Ce premier Sukuk sera directement orienté vers le financement de projets structurants et prioritaires identifiés par le Bureau National des Grands Projets. Il s’agit notamment de programmes d’infrastructures routières, d’écoles et d’hôpitaux, considérés comme urgents et à fort impact socio-économique. L’approche retenue est novatrice : au lieu de recourir à un endettement classique nécessitant une garantie souveraine et alourdissant la dette extérieure, le Sukuk repose sur un mécanisme d’investissement participatif. Les investisseurs apportent leur capital, lequel est adossé à des actifs tangibles de l’État, et en contrepartie, ils perçoivent des loyers prédéfinis.
C.F : Quels sont les montants recherchés à travers ce Sukuk historique ?
I.M : Tout est défini : les montants recherchés, les différents compartiments, les marges, les sous-jacents et les projets. Mais dans la politique de IFI, nous communiquons sans préciser le montant, ni les sous-jacents, ni les compartiments, tant que nous n'avons pas reçu le visa de l'AMF-UMOA, l’autorité de régulation du marché financier régional. Par ailleurs, nous pouvons vanter les mérites des Sukuks dans notre pays en particulier et la sous-région en générale, sans donner de précision sur une émission particulière jusqu’à ce qu’officiellement nous ayons le visa de l’AMF-UMOA, malgré que nous ayons déjà depuis avril 2025 le mandat officiel de l’Etat.

C.F : Au jour d'aujourd'hui, à quelle étape se trouve cette opération ? Et à quand le lancement proprement dit de ce Sukuk sur le marché financier ?
I.M : Nous sommes à environ 75% d’avancement. La note d’information est quasi finalisée, les projets éligibles identifiés, et les actifs sous-jacents en cours d’évaluation. Il reste à certifier cette évaluation par un commissaire aux comptes, officialiser le FCES, puis mettre en place le Sharia Board (conseil de conformité religieuse), garant de la gouvernance éthique avant, pendant et après l’émission.
Quand on finit avec toutes ces étapes, le dossier est soumis à l'AMF-UMOA qui donne son visa. Après le visa, on a un délai de six mois pour lancer l’opération. Une fois le visa obtenu de l’AMF-UMOA, nous envisageons un lancement entre mi-octobre et début novembre 2025.
C.F : Et qui compose le Board Sharia ?
I.M : Il est composé d’experts nationaux et internationaux chevronnés qui sont spécialistes de la finance islamique et qui ont un certificat Sharia Board.
C.F : En tant qu'acteur du marché financier et spécialiste de la finance islamique, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de l'Etat du Burkina de lancer cette opération historique, son tout premier Sukuk sur le marché financier régional ?
I.M : Pour nous, cette décision était inévitable et même attendue, au regard de la vision des autorités qui cherchent à diversifier les sources de financement, à réaliser des projets d’impact et à réduire la vulnérabilité liée à la dette classique. Dans une quête de souveraineté économique et financière, il devenait logique que le Burkina explore les instruments de la finance islamique, et particulièrement le Sukuk, qui constitue un outil éthique, inclusif et durable.
Nous nous y étions préparés en amont, convaincus que ce sujet finirait par arriver sur la table. Lorsque l’État a exprimé sa volonté d’aller dans cette direction, nous étions déjà prêts à apporter notre expertise et à structurer cette opération historique.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons d’avoir en face de nous un gouvernement visionnaire, qui innove, qui se projette dans l’avenir et qui cherche à concilier souveraineté, impact social et respect des valeurs de la population. La SGI-IFI est née à un moment où toutes les conditions sont réunies pour concrétiser ce que nous avions toujours voulu faire : proposer des instruments financiers adaptés à notre contexte, plus inclusifs et plus soutenables que les produits conventionnels.
Il faut rappeler qu’une grande partie de la population burkinabè épargne déjà, via les tontines précisément, parce qu’elles ne comportent pas d’intérêt. Cette masse financière informelle est immense, mais elle reste en marge du système financier classique à cause des convictions religieuses et éthiques de nombreux citoyens. Le Sukuk et la finance islamique apportent un cadre réglementaire et institutionnel à cette réalité, permettant à ces épargnes d’être mobilisées pour financer des projets nationaux. Et il est important de préciser que la finance islamique n’est pas uniquement destinée aux musulmans : elle repose sur des principes éthiques universels, présents dans toutes les religions monothéistes, qui bannissent l’usure et prônent l’équité. Elle constitue donc une finance inclusive par essence.
C.F : On peut donc conclure qu’en s’orientant vers les instruments financiers islamiques, l’objectif de l’Etat burkinabè est d'élargir ses possibilités de mobilisation des ressources, d’aller vers sa souveraineté financière, économique…
I.M : Absolument. L’État burkinabè a fait le choix courageux et stratégique de renforcer sa souveraineté en mettant en avant une finance inclusive. Depuis longtemps, nous parlons d’inclusion financière, mais dans la pratique, peu d’instruments adaptés aux réalités locales ont été développés. Or, l’inclusion ne peut se concrétiser que si l’on propose des solutions conformes aux besoins et aux valeurs des populations.
Nombreux sont ceux qui épargnent de manière informelle ou gardent leur argent à domicile, parce qu’ils n’ont pas trouvé de produits financiers compatibles avec leur éthique. En introduisant le Sukuk et, plus largement, la finance islamique, l’État ouvre la voie à une mobilisation plus large et plus diversifiée de l’épargne nationale et de la diaspora.
C’est une décision historique qui mérite d’être saluée. Elle démontre que les autorités sont à l’écoute de toutes les composantes sociales et religieuses du pays, et qu’elles entendent donner à chacun la possibilité de participer au développement de la Nation. Pour ma part, si je devais attribuer un trophée, je le décernerais sans hésiter au Président du Faso pour cette orientation visionnaire qui ancre définitivement le Burkina dans la voie d’une finance souveraine, inclusive et durable.
C.F : Quel est le rôle de votre SGI, IFI, dans cette opération ?
I.M : Dans cette opération, SGI-IFI agit comme arrangeur exclusif et chef de file du placement. Cela signifie que nous avons la responsabilité intégrale de la conception, du montage financier et juridique de l’émission, en conformité avec les standards de l’AMF-UMOA et les principes de la finance islamique.
Concrètement, nous structurons l’opération de bout en bout : élaboration de la note d’information, mobilisation et coordination des investisseurs, supervision de la certification du Sharia Board, et suivi technique avant, pendant et après l’émission. Nous assurons également le respect strict des procédures réglementaires afin d’obtenir le visa de l’AMF-UMOA et garantir une opération irréprochable.
SGI-IFI est donc le chef d’orchestre de cette opération. Nous concevons le Sukuk, organisons sa structuration, mobilisons les investisseurs et veillons à ce que l’opération respecte à la fois les règles du marché régional et les principes éthiques de la finance islamique. Notre rôle est de coordonner tous les acteurs — État, investisseurs, commissaires aux comptes, Sharia Board, régulateur — pour que l’émission se déroule dans la transparence, la sécurité et l’efficacité.
C.F : Qui peut souscrire à cette opération de Sukuk ?
I.M : Le Sukuk est par nature un instrument ouvert et inclusif. Tout citoyen burkinabè ou tout investisseur intéressé par une épargne éthique peut y souscrire. Cependant, les principaux souscripteurs visés sont les investisseurs institutionnels spécialisés : banques islamiques, institutions de microfinance islamiques, compagnies d’assurances et de réassurance Takaful, ainsi que les grands fonds islamiques tels que la Banque Islamique de Développement (BID).
Mais il est essentiel de rappeler que le Sukuk ne se limite pas aux institutions. Il est aussi destiné aux particuliers qui souhaitent investir conformément à leur foi et à leurs valeurs. C’est une opportunité unique pour chaque citoyen de participer au financement d’infrastructures nationales tout en ayant la garantie que son épargne est placée dans un cadre transparent, licite et porteur de développement.
C.F : Ce que vous dites sous-entend-il que seuls les investisseurs institutionnels sont autorisés à souscrire à cette opération ?
I.M : Non, absolument pas. Le Sukuk reste un instrument ouvert à la fois aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Toutefois, il s’inscrit dans une logique d’investissement éthique. La différence avec les obligations classiques est que le Sukuk doit respecter des principes stricts de conformité à la Charia.
Les institutions spécialisées, telles que les banques islamiques, les compagnies d’assurance Takaful ou les fonds islamiques, disposent déjà de leurs propres Sharia Boards internes, ce qui garantit que leurs placements respectent ces normes. Lorsque ces acteurs institutionnels participent, nous avons donc la certitude que les fonds mobilisés ne compromettront pas la conformité chariatique de l’opération.
C.F : Est-ce à dire qu’avec les investisseurs personnes physiques, il est difficile de vérifier le respect de la norme Charia ?
I.M : Pour les investisseurs particuliers, un processus de due diligence est prévu. Lors de la souscription, chaque investisseur devra remplir un formulaire précisant son activité et la source de ses revenus. Le Sharia Board, qui est l’organe indépendant de supervision religieuse et éthique, examinera ces informations pour s’assurer que les fonds proviennent d’activités licites.
Ainsi, si une personne exerce une activité explicitement interdite par la Charia, sa souscription sera rejetée. C’est une garantie essentielle pour protéger la crédibilité et l’intégrité du Sukuk.
L’objectif n’est pas d’exclure, mais d’assurer que les ressources mobilisées proviennent uniquement de sources conformes. Cela renforce la confiance des investisseurs et crédibilise encore davantage le marché naissant de la finance islamique au Burkina Faso.
C.F : Quels sont ces activités illicites qui sont exclues ?
I.M : La finance islamique repose sur des principes clairs qui définissent les secteurs d’activité considérés comme illicites, appelés haram. Ces activités incluent, entre autres, le commerce ou la production de boissons alcoolisées, le trafic ou la transformation de porc, les jeux de hasard, la spéculation purement usuraire (gharar), ainsi que toutes les activités frauduleuses ou contraires à l’éthique comme l’arnaque, la corruption ou le blanchiment d’argent.
Ces exclusions ne doivent pas être vues comme des contraintes, mais plutôt comme une garantie de transparence, d’intégrité et de traçabilité des fonds mobilisés. Au Burkina Faso et dans l’espace AES, plus de 65 % de la population pratique déjà une épargne qui, de fait, répond à ces exigences éthiques, notamment à travers les tontines et d’autres formes d’épargne communautaire. Pour ces épargnants, le Sukuk représente un canal idéal : il leur permet d’investir dans un cadre réglementaire, sécurisé, conforme à leurs valeurs, tout en participant au financement de projets structurants pour leurs pays. C’est précisément cette convergence entre éthique, inclusion et développement qui fait la force de la finance islamique. La finance islamique offre donc à l’Afrique une voie souveraine et durable, capable de mobiliser des ressources massives tout en restant fidèle à ses valeurs.
C.F : Vous avez lancé un appel à une alliance stratégique pour la réussite de cette opération. Concrètement, qu’est-ce que vous attendez ou recherchez à travers cet appel ?
I.M : Il y a un dicton qui m'a toujours plu depuis que j'étais petit :"c'est deux mains qui se lavent » ! Autrement dit, tu as beau être fort, si tu veux être très opérationnel, il faut travailler avec les autres ! L’appel à une alliance stratégique repose sur une conviction simple : dans le domaine financier, surtout lorsqu’il s’agit d’introduire un instrument aussi novateur que le Sukuk, la réussite repose sur la mutualisation des forces et des expertises.
Notre SGI-IFI dispose des compétences techniques et de l’expérience nécessaires pour mener seule cette structuration. Mais, l’ambition ne se limite pas à réussir une seule émission : nous voulons instaurer un écosystème durable de finance islamique au Burkina Faso et dans la sous-région. Cela suppose de bâtir une architecture inclusive, solide et crédible, qui dépasse la logique de compétition et s’inscrit dans une logique de coopération stratégique.
S’allier, ce n’est pas être faible, c’est au contraire vouloir être imbattable. Dans la finance islamique, l’esprit de partenariat est au cœur du modèle. En invitant d’autres acteurs à collaborer, nous envoyons un signal fort : ce marché est ouvert, transparent et tourné vers la pérennité. Notre vision est claire : mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel qui fera du Sukuk une alternative durable aux obligations conventionnelles.
C.F : Quel est l’état des lieux de l’utilisation des Sukuk sur le marché financier de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) ?
I.M : Le marché régional en est encore à une phase d’initiation. Le Sukuk reste un instrument jeune, qui exige une structuration beaucoup plus rigoureuse qu’une obligation conventionnelle. Contrairement à l’obligation classique, où un garant couvre les risques et où l’investisseur ne prend pratiquement aucun risque, le Sukuk repose sur un partage réel du risque et du rendement entre l’émetteur et les investisseurs. Cela signifie qu’au lieu de recevoir un intérêt fixe prédéterminé, l’investisseur perçoit des dividendes variables, issus des performances de l’actif financé. Par exemple, une émission peut générer un rendement de 6 à 7 % l’an, mais ce rendement dépend de la bonne exécution et de la rentabilité du projet sous-jacent.
Cette spécificité implique que la gouvernance et le contrôle doivent être irréprochables. Chaque Sukuk doit être structuré avec un suivi de bout en bout, une transparence totale et des mécanismes de gouvernance qui anticipent les difficultés avant qu’elles ne surviennent. C’est ainsi que l’on protège les investisseurs, crédibilise l’instrument et que l’on consolide la confiance dans un marché encore jeune. L’enjeu n’est donc pas seulement d’émettre un Sukuk, mais de bâtir un marché de référence, capable d’attirer durablement les investisseurs locaux, régionaux et internationaux.
C.F : Certes, le Burkina Faso est à sa première obligation islamique, mais le Sukuk n’est pas nouveau sur le marché financier régional …
I.M : Effectivement. Plusieurs États de la sous-région — comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Togo — ont déjà émis des Sukuk souverains via la BRVM. Mais ces opérations sont restées rares et relativement ponctuelles, pour plusieurs raisons :
- Complexité de structuration : le Sukuk exige une architecture juridique et financière plus sophistiquée que les obligations classiques ;
- Maturité du marché : ce type d’instrument nécessite une culture financière solide, encore en construction dans de nombreux pays de l’espace UEMOA ;
- Éducation financière : la plupart des investisseurs ne maîtrisent pas encore les mécanismes du Sukuk — dont la logique repose sur le partage des risques et des bénéfices, non sur l’intérêt fixe comme dans les obligations traditionnelles.
C.F : Quels sont les montants déjà mobilisés sur le marché de la BRVM, à travers le Sukuk ?
I.M : Voici quelques chiffres concrets, sur les émissions souveraines régionales :
- Sénégal : 100 milliards FCFA (~166 M$) en 2014, puis 150 milliards FCFA (~229 M€) en 2016, et un Sukuk Ijarah de 330 milliards FCFA (~525 M$) en 2022 ;
- Côte d’Ivoire : environ 150 milliards FCFA (~250 M$) en 2015 ;
- Togo : 156 milliards FCFA (~259 M$) émis en 2016, avec des remboursements en cours.
Ces émissions existent donc, mais restent limitées. Leur rareté tient à la complexité du montage du Sukuk, au manque de maturité du marché et au besoin d’un plus grand niveau de compréhension de ce nouvel instrument, fondé sur le partage actif des risques et des bénéfices, et non sur l’intérêt fixe.
C.F : Quels sont les avantages d’un Sukuk, comparativement aux titres classiques du marché financier ?
I.M : Le Sukuk présente plusieurs avantages majeurs qui le distinguent fondamentalement des obligations conventionnelles.
- Pas de dette au sens classique : pour l’État émetteur, un Sukuk n’est pas comptabilisé comme une dette extérieure classique, mais comme un financement adossé à des actifs. Cela améliore son image auprès des agences de notation financière et renforce sa soutenabilité budgétaire.
- Conformité éthique et inclusive : le Sukuk respecte les convictions religieuses et éthiques des investisseurs, dans un contexte où une part importante de la population africaine rejette l’usure (Riba). Il attire ainsi non seulement les institutions financières islamiques (banques, Takaful, fonds spécialisés, Banque Islamique de Développement), mais aussi les particuliers soucieux d’épargner de manière éthique. C’est un instrument universel, car toutes les grandes religions proscrivent l’intérêt abusif.
- Adossement à des actifs tangibles : contrairement aux obligations classiques garanties par une promesse financière abstraite, le Sukuk est adossé à des actifs réels — immeubles, infrastructures, équipements publics — que l’on peut identifier et valoriser. Cela renforce la confiance des investisseurs.
- Mobilisation rapide des ressources : les investisseurs institutionnels spécialisés sont déjà connus et n’investissent que dans des instruments conformes à la Charia. Il suffit donc de constituer un syndicat d’investisseurs stratégiques pour que la mobilisation soit rapide et efficace. À titre d’exemple, au Sénégal ou au Nigeria, la quasi-totalité des émissions de Sukuk a été souscrite en quelques jours.
- Stabilité des flux et préservation de valeur : étant adossés à des actifs physiques, les Sukuk offrent une stabilité que les obligations classiques ne garantissent pas. Par exemple, un bâtiment ou une route conserve sa valeur indépendamment d’une dévaluation monétaire, alors qu’une garantie purement financière doit être constamment réévaluée en cas de variation des taux de change.
- Fidélisation des investisseurs : la plupart des investisseurs en Sukuk sont captifs, car leurs mandats d’investissement excluent les produits conventionnels. Une fois leurs Sukuk arrivés à maturité, ils recherchent immédiatement de nouvelles émissions pour réinvestir. Cela crée un marché dynamique et auto-entretenu, qui encourage les États à multiplier les programmes.
En résumé, le Sukuk combine soutenabilité budgétaire, transparence, inclusion financière et stabilité, tout en ouvrant la voie à une diversification des sources de financement, indispensable pour nos États en quête de souveraineté économique.
C.F : Vous êtes donc de ceux qui présentent les Sukuk aujourd’hui comme une véritable alternative pour le financement des infrastructures de développement en Afrique, surtout subsaharienne…
I.M : Absolument. Les Sukuk s’imposent aujourd’hui comme une alternative crédible et durable au financement classique des infrastructures. L’Afrique a un besoin massif d’investissements dans les routes, les hôpitaux, les écoles, les énergies renouvelables, et ces projets nécessitent des ressources importantes mais surtout soutenables.
L’avantage majeur du Sukuk est qu’il permet de mobiliser des fonds significatifs sans alourdir la dette extérieure au sens classique. C’est un outil de financement participatif adossé à des actifs réels, qui renforce la soutenabilité budgétaire des États et rassure les investisseurs internationaux. Plus qu’un instrument, le Sukuk est un levier de souveraineté et de transparence pour l’Afrique.
De plus, le Sukuk ouvre des canaux de financement nouveaux et stratégiques :
- La diaspora africaine, qui dispose de liquidités importantes, mais recherche des placements transparents et conformes à ses valeurs.
- Les fonds et institutions islamiques (banques, Takaful, Banque Islamique de Développement, fonds souverains du Golfe), qui ne peuvent investir que dans des produits conformes à la Charia.
Un autre atout majeur est la transparence. Lorsqu’un État émet un Sukuk pour financer une route ou un hôpital, les fonds ne peuvent être utilisés qu’à cette fin précise. Les investisseurs savent exactement où va leur argent et peuvent suivre l’avancement du projet. Cela crée un lien de confiance inédit entre l’État et ses partenaires financiers.

À l’inverse, dans le cas d’une obligation conventionnelle, l’investisseur attend uniquement le paiement de ses intérêts, indépendamment du fait que les projets annoncés aient été réalisés ou non. Le Sukuk, lui, engage toutes les parties dans une logique de partage de responsabilité, de résultats et de transparence, ce qui correspond parfaitement aux attentes actuelles en matière de bonne gouvernance et d’impact social.
C.F : Malgré ses avantages, l’utilisation généralisée des Sukuk sur le marché financier régional se heurte encore à de nombreuses contraintes. Quels sont les défis à surmonter pour que cet instrument devienne un véritable levier de financement alternatif en Afrique subsaharienne ?
I.M : Trois grands défis se présentent à nous si nous voulons faire du Sukuk un véritable outil de financement structurant pour l’Afrique subsaharienne.
- Le défi juridique :
Le premier obstacle est d’ordre légal et réglementaire. Nos États doivent adapter leur cadre juridique pour reconnaître pleinement les contrats issus de la Charia (Ijara, Musharaka, Mudaraba, etc.). Aujourd’hui, beaucoup d’opérations nécessitent encore des contorsions juridiques, car nos codes financiers ne sont pas conçus pour accueillir ces instruments. La mise en place d’un Sharia Board national, comme on en trouve déjà dans certains pays pionniers, permettrait de certifier les produits de manière centralisée, d’harmoniser les pratiques et de rassurer les investisseurs internationaux. Cela donnerait une assise solide et une reconnaissance institutionnelle à la finance islamique dans nos pays.
- Le défi opérationnel :
Le deuxième défi concerne l’identification et la valorisation des actifs publics. Un Sukuk doit toujours être adossé à des actifs tangibles : barrages, routes, bâtiments administratifs, infrastructures éducatives ou sanitaires. Or, dans beaucoup de nos pays, ces actifs ne sont pas systématiquement inventoriés, ni évalués. À chaque opération, l’administration se met dans l’urgence pour retrouver factures et justificatifs de construction. Il faut sortir de cette logique réactive. Ce qu’il faut mettre en place, c’est un répertoire national des actifs mobilisables, régulièrement mis à jour et audité, qui servirait de base à la structuration de Sukuk souverains ou privés. Avec une telle base de données, il serait possible de programmer à l’avance des émissions, de gagner du temps et surtout de mobiliser des volumes plus importants de financement de façon planifiée et crédible.
- Le défi de la sensibilisation et de la culture financière :
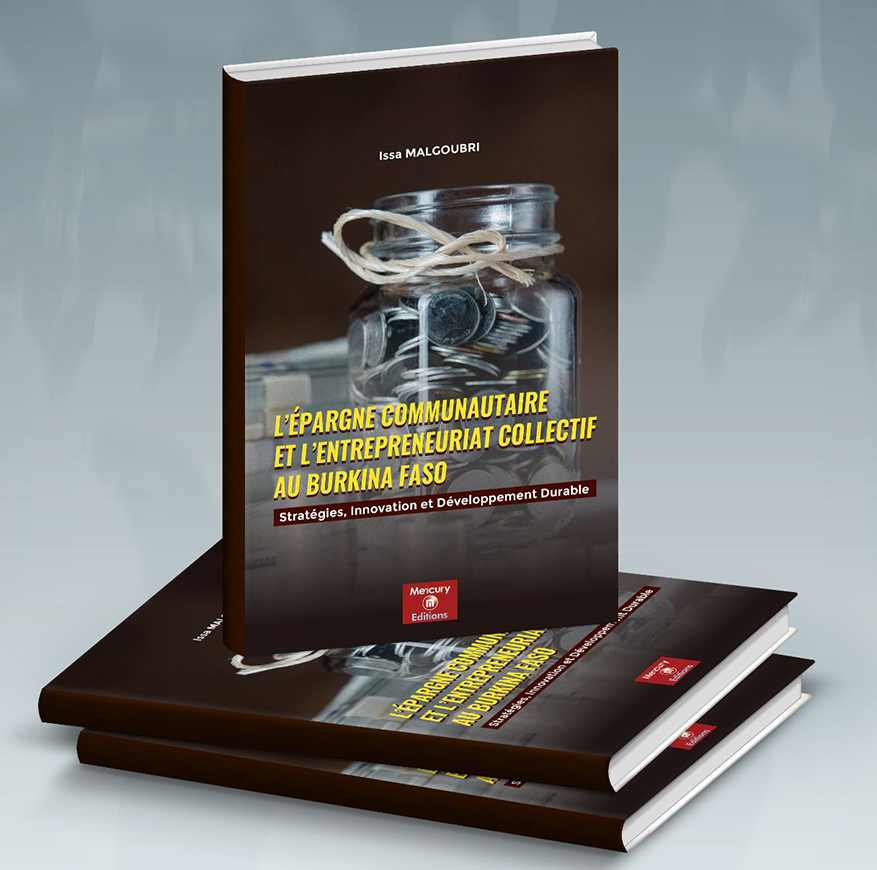
Enfin, le troisième défi est celui de la compréhension et de l’appropriation. Beaucoup de décideurs, d’investisseurs institutionnels, de banquiers et même de citoyens connaissent encore mal le Sukuk. Certains assimilent encore la finance islamique uniquement à une finance religieuse, alors qu’il s’agit d’une finance éthique, fondée sur la transparence, l’équité et le partage des risques. Il faut donc éduquer, former et vulgariser. Les conférences, séminaires, programmes de formation et campagnes de communication doivent multiplier les explications concrètes : comment fonctionne un Sukuk ? pourquoi il est sécurisé ? en quoi il bénéficie à l’État, aux investisseurs et à la population ?
Chez SGI-IFI, nous travaillons déjà sur ces trois axes. Notre objectif est simple : montrer que la finance islamique n’est pas une alternative marginale, mais un instrument stratégique, capable de transformer notre manière de financer le développement, tout en respectant les convictions et en élargissant l’inclusion financière.
Interview réalisée par la
Rédaction de C’Finance








