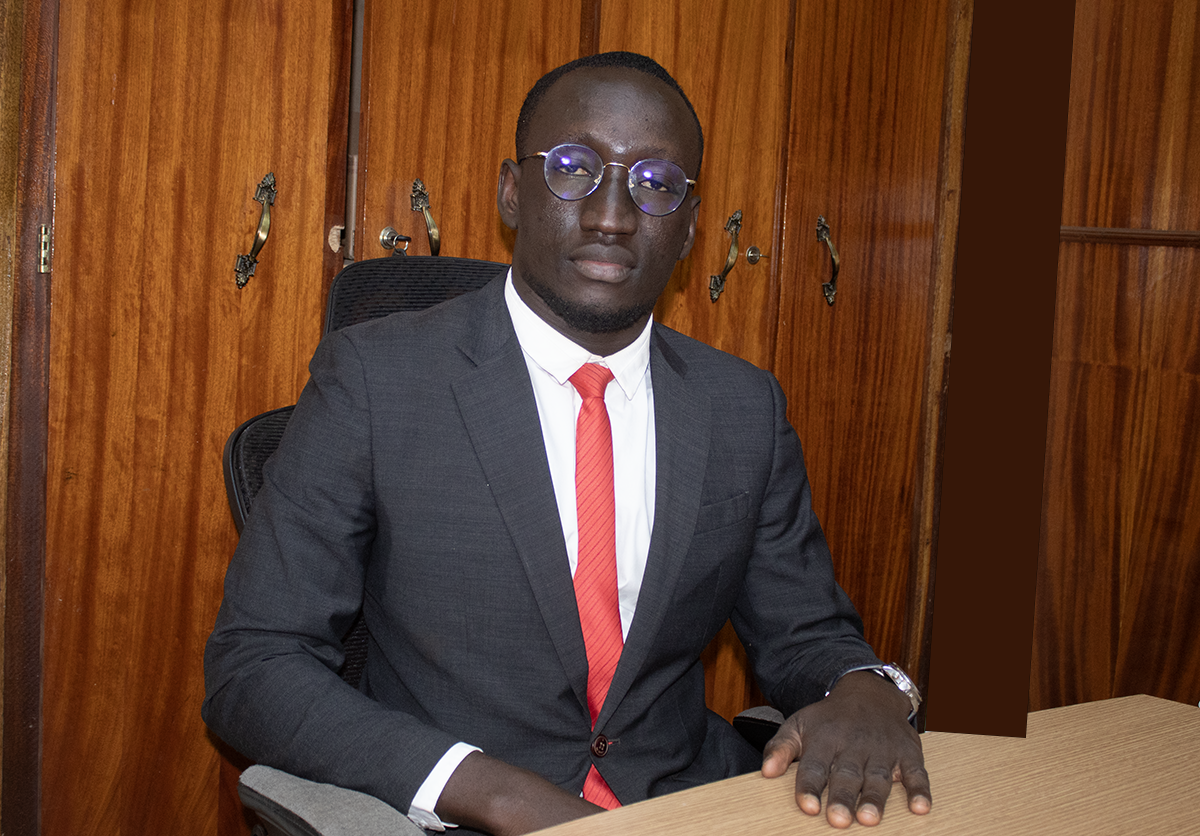Le blanchiment d’argent est un gouffre financier pour les Etats et une source de financement du terrorisme. Les manifestations et l’ampleur du phénomène sont souvent ignorés ou méconnus du grand public. Dans cet entretien à C’Finance, votre média spécialisé en information financière, l’expert en conformité, Azaviel Noha Kevin Somda, décrypte ces fléaux de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, leurs manifestations et impacts, ainsi que les solutions pour y faire face. Mr Somda se prononce également sur la présence du Burkina Faso sur la liste grise du GAFI mais aussi sur les récentes mesures prises par le gouvernement burkinabè dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour ce juriste de formation, ayant travaillé comme analyste financier au sein d’institutions financières internationales, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les populations ont un rôle fondamental à jouer… Lisez !
C’Finance (CF) : Comment peut-on définir le blanchiment d’argent, en termes simples ?
Azaviel Noha Kevin Somda (A.N.K.S.) : Le blanchiment d'argent consiste à utiliser de l'argent provenant de sources illicites afin de les intégrer dans le circuit économique légal pour lui donner une apparence propre. La question du financement du terrorisme est un peu différente de celle du blanchiment, en ce sens que le financement du terrorisme peut se faire avec de l'argent provenant de sources illicites pour financer des activités ayant des fins malicieuses, notamment un impact sur le plan sécuritaire.
Mais il y a aussi l'autre côté du financement du terrorisme qui consiste à noircir l'argent propre, c'est-à-dire que des personnes physiques ou morales ayant de l'argent acquis de manière licite, légale, vont utiliser cet argent-là pour financer des ambitions destructrices.
CF : Quelles sont les pratiques de blanchiment d’argent ?
A.N.K.S. : En ce qui concerne les pratiques, couramment on a un schéma qui se subdivise en trois phases : le placement, l'empilage et l'intégration. Le placement, c'est la phase où les fonds provenant d'une origine délictuelle sont intégrés dans l'institution financière. Par exemple, une personne, qui prétend être commerçant, dépose sur son compte dans une institution financière quelconque une grande quantité d’argent. Ensuite, il y a la phase de l'empilage ; elle peut se faire par une série de transactions inhabituelles ou de transactions complexes sous le couvert d'une activité prétendue. Enfin, il y a la phase de l'intégration, une fois que ces opérations sont passées, elles sont intégrées dans le circuit économique, et ont une apparence licite.
Classiquement, le schéma du blanchiment est ainsi, mais il y a bien sûr énormément de scénarios et de canaux par lesquels les personnes qui pratiquent le blanchiment d'argent peuvent passer.
CF : Quels sont les secteurs d’activité dans lesquels l’activité de blanchiment d’argent est plus développée ?
A.N.K.S. : En ce qui concerne les secteurs d'activité, une classification des risques a permis d'identifier des activités qui font partie des secteurs les plus exposés au blanchiment. On a, par exemple, les activités qui génèrent énormément de cash-flow, de liquidités telles que les activités de commerce. On a aussi le secteur de l’hôtellerie, celui des bureaux de change etc. Toutes ces activités sont quelques exemples de secteurs potentiellement à risque.
Aujourd'hui, l'import-export est considéré comme l'un des secteurs à risque élevé de blanchiment de capitaux. En ce qui concerne le change de devises, il y a certaines transactions à destination de pays qui sont potentiellement à risque élevé ou à destination de fournisseurs qui sont à risque élevé, qui peuvent engendrer des fraudes liées au change, au détournement d'objet des fonds.
CF : Certains estiment que les activités de certaines ONG participent au blanchiment de capitaux. Qu’en est-il exactement ?
A.N.K.S. : Dans notre jargon, les ONG sont qualifiées d’OBNL (organismes à but non lucratif). Il faut savoir que les organismes à but non lucratif font partie des assujettis à la loi relative au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. S’ils sont des assujettis à la loi contre le blanchiment, c'est justement parce que c'est un secteur potentiellement à risque élevé. Maintenant, il est vrai qu'il y a des suspicions concernant certaines activités liées aux ONG.
Mais ce qu'il faut noter ici, est qu'on ne peut pas dire que c'est effectivement le cas tant qu'il n'y a pas eu des investigations permettant d'aboutir à des conclusions concrètes. Cependant, étant donné qu’une cartographie des risques de blanchiment a été réalisée et que ce secteur a été placé comme un secteur à risque, cela signifie qu'il y a des diligences, notamment à l'échelle nationale, qui sont mises en place pour encadrer le secteur, pour mitiger le risque et pour s'assurer qu'on évite que ces ONG soient un canal par lequel des blanchisseurs d'argent puissent passer.
CF : Existe-t-il des ONG qui ont déjà été épinglées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme au Burkina Faso ou ailleurs dans le monde ?
A.N.K.S. : A l'échelle mondiale, oui ! Il y a des organisations telles que le groupe d'action financière (GAFI) qui, à travers les évaluations nationales des risques menées grâce aux antennes régionales réparties dans le monde, travaillent pour vraiment traquer ces points-là ; sans compter aussi les cellules nationales de renseignement qui veillent à ce que les transactions suspicieuses qui pourraient impliquer des organismes à but non lucratif puissent faire l'objet d'investigation et bien sûr aboutir aux conséquences de faits.

qui pratiquent le blanchiment d'argent peuvent passer.
CF : Comment est-ce que le phénomène du blanchiment est-il évalué ?
A.N.K.S. : Concrètement, cette évaluation se réalise, premièrement, à travers ce qu'on appelle les évaluations nationales des risques. Le Burkina Faso est sous la coupe du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment des capitaux (GIABA). A travers cet organisme, il y a des enquêtes nationales qui concernent les différents assujettis (les institutions financières, les cabinets d'expertise comptable, les avocats, les casinos, etc.). Et tous ces assujettis vont doivent produire des rapports qui sont censés être compilés.
En fait, ils vont répondre à des questionnaires, il y aura des enquêtes sur le terrain qui vont permettre de regrouper des informations qui feront l'objet d'un rapport. Ce rapport est aligné aux recommandations du GAFI. Cela permet d'évaluer l'ampleur du phénomène, de voir aussi l'état d'évolution du pays par rapport aux défis liés à la lutte contre le blanchiment.
CF : Quel est l’ampleur du blanchiment d’argent en termes de chiffres ?
A.N.K.S. : À l'échelle mondiale, selon les dernières statistiques, l'économie mondiale perd plus de 2000 milliards de dollars par an, à cause du blanchiment d'argent. À l'échelle sous régionale, on est à des centaines de milliards. Les chiffres sont bien sûr actualisés périodiquement au fur et à mesure que des évaluations nationales sont réalisées.
CF : Quel est l’impact du blanchiment sur le développement des pays ?
A.N.K.S. : L'impact sur le développement est très réel. Déjà, il y a un énorme manque à gagner. Un exemple tout simple. Des personnes qui pratiquent de la fraude douanière et qui utilisent les fonds objet de cette fraude pour les réintégrer dans le circuit licite. Cela signifie que concrètement il y a un manque à gagner dans les caisses de l’Etat. C'est un exemple concret qui montre que l’Etat perd beaucoup.
Et pire encore, il y a l'intégrité des institutions financières qui est remise en cause car si ces fonds transitent dans les institutions, cela a un poids, des conséquences ; d'autant plus qu'elles peuvent faire l’objet de sanctions. Ce qui n'est pas bon pour la réputation de ces institutions financières, tout comme pour le pays où elles sont implantées.
L'économie mondiale perd plus de 2000 milliards de dollars par an, à cause du blanchiment d'argent. À l'échelle sous régionale, on est à des centaines de milliards.
CF : Quelle est la situation du Burkina Faso en matière de blanchiment d’argent ?
A.N.K.S. : Le Burkina Faso est présentement sur la liste grise du GAFI. Cette liste grise du GAFI permet d'identifier les pays qui ont des défis stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux par rapport aux recommandations du GAFI. Lorsque le GIABA réalise des évaluations nationales des risques, ils vont évaluer la capacité de l'État à pouvoir être en conformité avec les recommandations du GAFI. Sur cette base, il y a des déficiences, il y a des axes stratégiques sur lesquels le Burkina Faso devra travailler pour pouvoir se mettre en conformité et ces points font l’objet d’un suivi périodique.

CF : Qu’est-ce qu’il est reproché concrètement aux pays qui figurent sur cette liste grise ?
A.N.K.S. : Le premier reproche est l'inadéquation des textes juridiques réglementaires par rapport à l'actualité de la liste grise du blanchiment. Aujourd'hui, le blanchiment des capitaux est un phénomène dynamique et naturellement, il faudrait que les États aient des lois qui sont adaptées aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Je prends l'exemple du registre national des bénéficiaires effectifs.
Aujourd'hui, de nombreux États n'ont pas encore opérationnalisé concrètement un registre national des bénéficiaires effectifs qui soit électronique, digitalisé, et permette d'assurer une certaine transparence, un certain suivi de ceux qui sont les bénéficiaires effectifs des entités qui existent dans nos pays. Ce qui fait qu'on a la possibilité de retracer où va l'argent et de contrôler l'économie. Aujourd'hui, c'est par exemple un des points sur lequel il faudrait mener plus de travail.
CF : D’autres pays de la sous-région figurent-ils sur cette liste du GAFI ?
A.N.K.S. : En dehors du Burkina, on a la Côte d'Ivoire qui a intégré cette liste tout récemment. On a le Mali aussi qui fait partie, entre autres.
CF : Et des pays qui n’y figurent pas ?
A.N.K.S. : Il y a des pays qui ont un meilleur comportement qui ne figurent pas encore sur cette liste. En Afrique de l’ouest, on a par exemple le Ghana qui ne fait pas partie de la liste grise. Le Sénégal est sorti de la liste tout récemment ; et c'est donc un pays qui s'est illustré par sa capacité à pouvoir résorber les défis auxquels il était confronté.
CF : Quelles sont les autres classifications en dehors de la liste grise ?
A.N.K.S. : Il y a la liste noire du GAFI, qui est vraiment la liste où il ne faut absolument pas figurer. C'est la liste des pays qui sont blacklistés au vrai sens du terme. Il y a par exemple le Myanmar. Heureusement, on n'a pas de pays africains qui font partie de cette liste noire.
CF : Qu’est-ce que cela implique pour un pays de figurer sur la liste grise ou noire du GAFI ?
A.N.K.S. : En ce qui concerne la liste noire, y figurer signifie tout simplement que vous n'aurez plus la possibilité d'effectuer des transactions avec la quasi-totalité des pays qui sont affiliés au GAFI. Vous êtes placés en rouge en ce qui concerne l'évaluation des risques, ce qui fait que les investisseurs n'auront plus envie de collaborer avec vous ; la coopération internationale va fortement être impactée aussi. C’est comme si vous êtes isolés du monde financier.
Maintenant, pour la liste grise, les répercussions sont que le pays qui y figure est classé aussi en risques élevés ; sauf que cela va engendrer des mesures de vigilance renforcées. Lorsqu’un Etat sur cette liste envisage, par exemple, des relations avec des institutions financières internationales, ces dernières vont regarder l’évaluation des risques du pays en question en termes de blanchiment. Si le risque est élevé, ils vont demander plus de diligence, plus de documentation, plus de preuves que l’Etat a encadré cette exposition par rapport à une transaction précise ou par rapport aux relations d'affaires précises. Et puis, deuxièmement, il y a aussi des investisseurs qui ne sont pas prêts à investir dans un pays qui est classé à risque élevé.
CF : Quelles sont les principales recommandations que le GIABA a formulées pour le Burkina Faso dans son dernier rapport ?
A.N.K.S. : Lorsque le GIABA a mené sa dernière évaluation nationale des risques, qui date de 2023, il est précisé que le Burkina Faso a fait des évolutions sur les recommandations du GAFI. Par contre, il y a toujours des actes d'amélioration en ce qui concerne la recommandation numéro 22 par exemple, sur le dispositif de LCBFT (ndlr : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) portant sur les obligations de conservation des dossiers pour les agents immobiliers, les négociants de métaux précieux.
Ce sont là des exemples d’éléments pour lesquels le Burkina Faso a toujours des défis à relever. Et justement, vous avez posé la question de savoir quels sont les secteurs à risque, les métaux précieux et le secteur immobilier en font aussi partie.
CF : Est-ce que les réformes exigées n’impliquent pas de disposer d’un certain niveau de ressources ?
A.N.K.S. : Oui, il y a effectivement une question de ressources, surtout en termes de ressources humaines. Et ensuite, il y a aussi une question de volonté politique, de volonté étatique, j'allais dire, car il faudrait que cela soit placé au top niveau des priorités de nos gouvernements. Et je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est vraiment dans cette dynamique-là.
CF : Que peut-on retenir également de la dernière réunion du GAFI concernant les pays d’Afrique de l’Ouest ?
A.N.K.S. : La dernière plénière du GAFI a effectivement fait ressortir des conclusions intéressantes pour l'Afrique de l'Ouest. Premièrement, il y a la bonne nouvelle, qui est que le Sénégal est sorti de la liste grise. Et il faut noter que cette sortie n'est pas anodine, c'est le fruit d'un travail harmonieux de tous les acteurs en ce qui concerne la résolution des différents points qui ont été soulevés par le GAFI, pour cet Etat. Et c'est un processus qui a débuté en 2021 et, bien sûr, couronné par cette décision du GAFI.
Le deuxième point est l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la liste grise du GAFI. On va dire que c’est le petit bémol dans ces conclusions. Mais, comme je l'ai dit, s'ils ont été placés sur cette liste, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement grave, c'est plutôt un appel à faire mieux, à améliorer le dispositif par rapport aux enjeux liés à l'échelle nationale pour la Côte d'Ivoire.
CF : Que fait le Burkina Faso concrètement pour sortir de la liste grise du GAFI ?
A.N.K.S. : Il faut noter que le Burkina Faso a réalisé vraiment beaucoup d'efforts pour sortir de cette liste. Déjà, actuellement, il y a un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a aussi un autre projet en cours pour une nouvelle loi sur la réglementation des systèmes financiers décentralisés. Il y a par exemple le registre électronique des bénéficiaires effectifs qui est aussi en gestation. Il y a donc des points d'amélioration qui sont en train d'être faits concrètement et qui font qu'on est positif, optimiste à l'idée que le Burkina Faso puisse sortir de cette liste grise. En tout cas, dans un horizon proche.
CF : L’arrêté portant gel des avoirs de 115 personnes pour activités liées au terrorisme, pris par le ministre de l’Economie et des Finances, le mardi 19 novembre 2024, peut-il être considéré comme allant dans le sens de cette lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
A.N.K.S. : Cela démontre qu'on a un dispositif dynamique. Le gel des avoirs, il faut le dire, est vraiment une mesure rare, on le voit de plus en plus depuis ces cinq dernières années. Et aujourd'hui, c'est un signal fort aussi qui montre qu'on est capable de pouvoir appliquer certaines mesures qui pourraient être qualifiées d'extrêmes si les circonstances l'exigent.
Le Burkina Faso a réalisé vraiment beaucoup d'efforts pour sortir de la liste grise du GAFI.
CF : Concrètement, en quoi consiste le gel des avoirs ?
A.N.K.S. : Il s'agit d'une mesure par laquelle le Ministère en charge de l'Économie va ordonner à l'ensemble des institutions financières de bloquer l'ensemble des comptes de ceux dont les avoirs sont gelés. Cela signifie que si toutefois une personne détient 10 millions dans la banque X, elle ne pourra plus entrer en possession de ces fonds-là. Et si cette mesure a été appliquée, c'est certainement parce qu'ils se disent que derrière, il y a la possibilité que ces fonds puissent être utilisés à une fin qui n'est pas à l'avantage du pays.
Lire aussi : Lutte contre le terrorisme au Burkina : gel des avoirs de 115 personnes dont des anciens dignitaires
CF : La banque centrale (BCEAO) a édicté des mesures à observer par les institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment. Quelles sont ces mesures ?
A.N.K.S. : Effectivement, la Banque Centrale a pris beaucoup de mesures en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment. C'est à travers la Commission bancaire surtout que la Banque Centrale joue ce rôle de régulation des institutions financières.
Il y a des diligences concernant l'identification des clients, des diligences concernant l'obligation de surveillance des transactions de certains clients. Il y a des diligences en ce qui concerne des obligations de déclaration, des obligations de reporting qui sont faites périodiquement. Et toutes ces mesures sont des points qui permettent aussi à la Banque Centrale de mieux suivre, de mieux s'assurer que les assujettis répondent aux obligations pour encadrer la lutte contre le blanchiment.

électronique, digitalisé, et permette d'assurer une certaine transparence.
CF : Qui sont les assujettis à la réglementation contre le blanchiment de capitaux ?
A.N.K.S. : On a les banques, les microfinances, les établissements financiers, les professions financières non désignées, les casinos, les loteries nationales, les cabinets d'experts-comptables, les sociétés immobilières, entre autres.
CF : Il n’y a donc pas de personnes physiques parmi les assujettis définis par la loi ?
A.N.K.S. : Il n'y a pas de personnes physiques parmi les assujettis. C'est vraiment des personnes morales à travers lesquelles les personnes physiques vont entrer en relation pour réaliser certaines activités.
CF : Quelles sont les meilleures pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?
A.N.K.S. : En ce qui concerne les meilleures stratégies de lutte, premièrement, il y a le volet des institutions assujetties, notamment à la loi portant lutte contre le blanchiment. Il faut, dans un premier temps, avoir au moins un dispositif de base, des procédures, des politiques qui vont dans le sens d'encadrer la lutte contre le blanchiment. En matière de conformité dans les institutions financières, notamment, il y a des textes bien précis. Mais, il n'y a pas que les institutions financières, car on a tendance à penser que ce sont seulement les institutions financières qui doivent mener des diligences renforcées. On a le secteur immobilier qui est là. Ce sont des sociétés qui doivent avoir un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui doivent s'assurer que les transactions qui sont menées ne sont pas susceptibles de faire l'objet de blanchiment des capitaux.
Il y a aussi l'utilisation des outils du numérique aujourd'hui. Car, il faut le dire, on ne peut pas avoir un bon dispositif de gestion contre le blanchiment si on n'a pas les outils qui permettent de pouvoir générer des alertes pertinentes et de mener des investigations de qualité qui pourront éventuellement mener à des diligences plus poussées.
Deuxièmement, il y a le volet national en termes de stratégie. Déjà, l'une des meilleures stratégies est de se conformer aux recommandations du GAFI. Si on se conforme à ces recommandations-là, cela voudrait dire qu'on a un dispositif vraiment robuste, un dispositif qui est aligné aux défis du moment en matière de lutte contre le blanchiment.
Et troisièmement faudrait aussi une bonne coopération entre les cellules nationales de traitement de l'information financière (CENTIF). Car il faut le dire, le phénomène du blanchiment des capitaux n'est pas seulement national. Il y a des enjeux transnationaux, des scénarios qui impliquent plusieurs pays et il est bon qu'il y ait cette collaboration-là afin de pouvoir lutter efficacement contre le blanchiment.
Il serait intéressant que les populations puissent aussi avoir la culture de faire des déclarations de soupçon pour pouvoir signaler.
CF : D’où l’intérêt pour les assujettis de s’investir dans la conformité…
A.N.K.S. : Aujourd'hui, la conformité est parfois perçue comme un gouffre en termes d'investissement. Mais il faut la voir comme un moyen de capitalisation de nos acquis.Aujourd'hui, une institution financière qui investit dans la conformité est une institution qui investit pour sa pérennité. Les sanctions pleuvent dans le vrai sens du terme ; tout récemment le Collège de supervision de la Banque Centrale a encore pris des sanctions à l'égard de certaines institutions financières. Si ces sanctions ont eu lieu, c'est parce que leur dispositif n'était pas optimal.
C'est un réel appel à ce que l'ensemble des institutions, des assujettis puissent renforcer leur dispositif pour se conformer aux exigences du régulateur. Ce point est très déterminant pour mieux encadrer la lutte contre le blanchiment. C'est aussi un appel à tous les dirigeants, que ce soit des institutions publiques comme privées, à investir dans la conformité, à investir pour protéger les institutions, car 'on a beau faire beaucoup de chiffres lorsque votre réputation est entachée, lorsque vous avez des sanctions d’ordre financières, cela joue clairement sur votre activité et c'est quelque chose qu'on peut éviter en investissant pleinement dans la conformité.
CF : Les citoyens lambda ont-ils aussi un rôle à jouer dans cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, vu qu’il s’agit des phénomènes complexes voire sophistiqués, qui demandent une certaine expertise pour les cerner ?
A.N.K.S. : Je dirais oui. Oui, parce que c'est le citoyen en fait qui est le premier concerné en termes d'impact des conséquences liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Dans une certaine mesure, il serait donc intéressant que les citoyens puissent être sensibilisés sur par exemple les signaux d’alertes en matière du financement du terrorisme, les signaux d’alerte en matière de blanchiment des capitaux. Cela pourrait être un exemple tout banal. Vous avez peut-être dans votre quartier une connaissance ou un voisin, vous connaissez ses activités, vous savez qu'il a une petite boutique au grand marché, mais tout d'un coup, il construit un immeuble d'une valeur d’un milliard. On ne dit pas que vous l'accusez, mais cela reste un indicateur, surtout si vous n'avez pas la possibilité de comprendre.
Il serait intéressant que les populations puissent aussi avoir la culture de faire des déclarations de soupçon pour pouvoir signaler. Car, bien sûr, si toutefois il s’avère que cette personne-là a utilisé de l'argent provenant de sources illicites, cela veut dire que tous ceux qui sont dans ce quartier sont en danger. Et pire encore, s'il s'agit d'une question de financement du terrorisme, si cette personne s'est enrichie grâce à des fonds provenant de cette source, alors, cela signifie qu’il s’agit là d’un enjeu national. Et il va bien falloir que cette vigilance soit vraiment vulgarisée auprès de la population.
Interview réalisée par
Mouni N’GOLO et Ra-Yangnéwindé